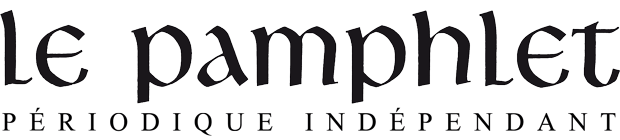Génocide et déicide
«En tant que notion abstraite et suffisante qui n’est subordonnée à rien de supérieur, l’idée de démocratie est une divinisation de l’homme et une négation de la source divine de l’autorité.»
Nicolas Berdiaeff: De l’inégalité, 8e lettre: De la démocratie, éd. de l’Age d’Homme, Lausanne 1976, p. 133.
Les législations d’Europe pénalisent, pour certaines d’entre elles, dont la Suisse, la négation d’un génocide. Elles le font au nom du respect de la mémoire des disparus dans la personne de leurs survivants. On peut se demander si la méthode est opportune. Eriger en une sorte de dogme séculier des faits relevant de l’histoire est une idée au fond assez voisine de celle de vérité d’Etat, héritage bien connu de tous les régimes totalitaires modernes. On peut aussi se demander pourquoi il faudrait limiter à l’histoire de tels interdits légaux. Des acquis scientifiques pourraient faire l’objet d’une protection pénale identique.
Cette mainmise de l’appareil d’Etat et de son système répressif dans des domaines qui leur étaient jusqu’ici étrangers s’accompagne curieusement et paradoxalement d’abandons sinon acquis, à tout le moins envisagés, dans un autre domaine où, l’histoire de toute l’humanité le prouve, la compétence de l’Etat à légiférer lui a toujours été reconnue, quand bien même cette compétence n’est pas pleinement autonome: la morale. Ainsi, on envisage dans certains milieux de proposer l’abrogation de l’inceste (art. 213 CPS), après d’autres réformes manifestant une protection de plus en plus rétrécie de la famille. C’est d’une certaine manière dans la logique de l’évolution moderne des mœurs.
Mais la question demeure, à laquelle on se garde bien de répondre dans les milieux antirévisionnistes: quelle est la raison d’être fondamentale et essentielle de l’interdit pénal? Si une société ne s’entend plus sur des normes générales d’ordre moral à protéger pénalement, au nom de quelle valeur morale précisément imposerait-elle encore des normes pénales à raison d’être historique ou scientifique? A la vérité, nous glissons infailliblement, sous ces apparences de justice, vers des Etats idéologiques, par ailleurs tant décriés… officiellement! La science d’Etat, l’histoire d’Etat donnent inéluctablement la morale d’Etat, et cette dernière n’est que le préambule à la religion d’Etat, une religion séculière sans doute, mais une religion tout de même.
Ainsi, l’autorité sociale et politique qui s’est voulue totalement sécularisée retrouve par ce mauvais chemin le principe religieux récusé au départ! Revenons au bon sens: laissons l’histoire aux historiens, la science aux scientifiques et le droit aux responsables politiques et sociaux, dont le comportement n’est jamais séparable des valeurs morales universelles, ni, bien entendu, du fait religieux, ceci pour la raison élémentaire que ces deux domaines ont pour caractère propre de limiter chez tous l’arbitraire, aussi bien celui des particuliers que des détenteurs de l’autorité publique, sans entamer en rien la dignité et le rôle spécifique de cette dernière.
Mais le fait d’ériger en délit le déni de génocide n’a pas qu’un sens humaniste. Il cache à l’arrière-plan une véritable idolâtrie de l’homme, non pas de tel homme en particulier, mais de son modèle collectif, désindividualisé. Or c’est bel et bien ce type d’homme abstrait qui, à travers ce nouveau délit, fait l’objet d’un culte idolâtrique n’osant dire son nom. La preuve? Au moment où le délit de déni de génocide fait son apparition dans plusieurs codes pénaux, celui de déicide disparaît même de la conscience religieuse chez beaucoup. Il n’en est plus question et ce fait n’est qu’une opinion. Liberté ou plutôt licence religieuse oblige: ce crime ne peut en effet être affirmé comme un fait historique sans considérer aussitôt le judaïsme et l’islam comme deux croyances religieuses à caractère incontestablement révisionniste…
Naturellement, tous les chrétiens dits progressistes qualifieront ce jugement d’outrancier, voire sectaire, la mort et la résurrection du Christ relevant de la seule foi chrétienne, au même titre que la négation à son sujet du déicide relève des croyances juive et musulmane. Mais l’Eglise ne l’a pas jugé ainsi qui, dans un décret du Saint-Office du 3 juillet 1907 sur les erreurs principales du modernisme, Lamentabili, condamne en particulier les deux propositions suivantes: «La résurrection du Christ n’est pas proprement un fait d’ordre historique» (no XXXVI) et «La foi en la résurrection du Christ, à l’origine, porte moins sur le fait lui-même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu» (no XXXVII).
L’évidence s’impose par conséquent: nier la mort et la résurrection du Christ relève bien de ce qu’on connaît aujourd’hui sous l’appellation de révisionnisme historique. Cette inconséquence des antirévisionnistes vaut sans doute d’être remarquée.
Michel de Preux
Nicolas Berdiaeff: De l’inégalité, 8e lettre: De la démocratie, éd. de l’Age d’Homme, Lausanne 1976, p. 133.
Les législations d’Europe pénalisent, pour certaines d’entre elles, dont la Suisse, la négation d’un génocide. Elles le font au nom du respect de la mémoire des disparus dans la personne de leurs survivants. On peut se demander si la méthode est opportune. Eriger en une sorte de dogme séculier des faits relevant de l’histoire est une idée au fond assez voisine de celle de vérité d’Etat, héritage bien connu de tous les régimes totalitaires modernes. On peut aussi se demander pourquoi il faudrait limiter à l’histoire de tels interdits légaux. Des acquis scientifiques pourraient faire l’objet d’une protection pénale identique.
Cette mainmise de l’appareil d’Etat et de son système répressif dans des domaines qui leur étaient jusqu’ici étrangers s’accompagne curieusement et paradoxalement d’abandons sinon acquis, à tout le moins envisagés, dans un autre domaine où, l’histoire de toute l’humanité le prouve, la compétence de l’Etat à légiférer lui a toujours été reconnue, quand bien même cette compétence n’est pas pleinement autonome: la morale. Ainsi, on envisage dans certains milieux de proposer l’abrogation de l’inceste (art. 213 CPS), après d’autres réformes manifestant une protection de plus en plus rétrécie de la famille. C’est d’une certaine manière dans la logique de l’évolution moderne des mœurs.
Mais la question demeure, à laquelle on se garde bien de répondre dans les milieux antirévisionnistes: quelle est la raison d’être fondamentale et essentielle de l’interdit pénal? Si une société ne s’entend plus sur des normes générales d’ordre moral à protéger pénalement, au nom de quelle valeur morale précisément imposerait-elle encore des normes pénales à raison d’être historique ou scientifique? A la vérité, nous glissons infailliblement, sous ces apparences de justice, vers des Etats idéologiques, par ailleurs tant décriés… officiellement! La science d’Etat, l’histoire d’Etat donnent inéluctablement la morale d’Etat, et cette dernière n’est que le préambule à la religion d’Etat, une religion séculière sans doute, mais une religion tout de même.
Ainsi, l’autorité sociale et politique qui s’est voulue totalement sécularisée retrouve par ce mauvais chemin le principe religieux récusé au départ! Revenons au bon sens: laissons l’histoire aux historiens, la science aux scientifiques et le droit aux responsables politiques et sociaux, dont le comportement n’est jamais séparable des valeurs morales universelles, ni, bien entendu, du fait religieux, ceci pour la raison élémentaire que ces deux domaines ont pour caractère propre de limiter chez tous l’arbitraire, aussi bien celui des particuliers que des détenteurs de l’autorité publique, sans entamer en rien la dignité et le rôle spécifique de cette dernière.
Mais le fait d’ériger en délit le déni de génocide n’a pas qu’un sens humaniste. Il cache à l’arrière-plan une véritable idolâtrie de l’homme, non pas de tel homme en particulier, mais de son modèle collectif, désindividualisé. Or c’est bel et bien ce type d’homme abstrait qui, à travers ce nouveau délit, fait l’objet d’un culte idolâtrique n’osant dire son nom. La preuve? Au moment où le délit de déni de génocide fait son apparition dans plusieurs codes pénaux, celui de déicide disparaît même de la conscience religieuse chez beaucoup. Il n’en est plus question et ce fait n’est qu’une opinion. Liberté ou plutôt licence religieuse oblige: ce crime ne peut en effet être affirmé comme un fait historique sans considérer aussitôt le judaïsme et l’islam comme deux croyances religieuses à caractère incontestablement révisionniste…
Naturellement, tous les chrétiens dits progressistes qualifieront ce jugement d’outrancier, voire sectaire, la mort et la résurrection du Christ relevant de la seule foi chrétienne, au même titre que la négation à son sujet du déicide relève des croyances juive et musulmane. Mais l’Eglise ne l’a pas jugé ainsi qui, dans un décret du Saint-Office du 3 juillet 1907 sur les erreurs principales du modernisme, Lamentabili, condamne en particulier les deux propositions suivantes: «La résurrection du Christ n’est pas proprement un fait d’ordre historique» (no XXXVI) et «La foi en la résurrection du Christ, à l’origine, porte moins sur le fait lui-même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu» (no XXXVII).
L’évidence s’impose par conséquent: nier la mort et la résurrection du Christ relève bien de ce qu’on connaît aujourd’hui sous l’appellation de révisionnisme historique. Cette inconséquence des antirévisionnistes vaut sans doute d’être remarquée.
Michel de Preux
Thèmes associés: Religion
Cet article a été vu 3821 fois