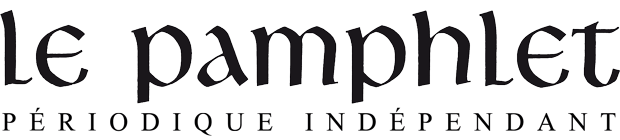Banques, finance et confusions
Beaucoup de crétineries se publient à propos des dérives du secteur bancaire, en particulier les critiques acerbes de ce qui mine Credit Suisse depuis une trentaine d’années1. Le problème que posent les banques débridées actuelles n’est ni de servir des clients privés et commerciaux, ni de s’occuper des finances des entreprises (corporate finance) mais bien celui du rôle qu’elles jouent dans les investissements qu’elles font pour elles-mêmes, notamment les «produits financiers (sic)» qu’elles mettent sur le marché dans cette seule intention.
Une banque sert à faire circuler de l’argent, à garder l’épargne des uns pour la prêter aux autres, crédits hypothécaires inclus. Ce banquier-là est plus comptable qu’aventurier. En corporate finance, une banque fournit des services aux entreprises afin qu’elles puissent être capitalisées, en bourse ou hors bourse, obtenir du crédit, contracter des emprunts ou structurer le côté financier de fusions ou d’acquisitions. Ce banquier-là doit bien connaître la vie des entreprises et les marchés des capitaux. La gestion de fortune est un autre service, avant tout pour garder en dépôt des portefeuilles privés ou collectifs (caisses de pension), conseiller les clients pour leurs placements ou même exécuter des mandats de gestion. Voilà ce que j’en comprends, et aussi que les exigences vertes, arc-en-ciel et autres (ESG) y mettent une dose de folie2.
Cependant cela ne limite plus à cela. C’est lorsque ces banques se sont muées en instituts financiers, faisant en quelque sorte concurrence aux banques nationales d’émission de monnaie, que cela a commencé à se gâter. La sélection des personnes pour diriger ces entités a été influencée par la poursuite de cet objectif; il n’est donc pas étonnant que les mauvais choix se soient répétés sans cesse et avec obstination.
Ayant été moi-même actif dans une industrie fabriquant des produits de nature matérielle, colorés ou non, odorants, toxiques, solides ou liquides, donc très concrets, j’ai vu arriver des producteurs de salon offrant des «produits» faits de papier écrit à l’encre sympathique.
A cette même époque, les habituels cabinets de conseil d’entreprise vinrent nous enseigner que notre matérialité n’était pas pertinente et que notre positionnement marketing devait se concevoir comme un service rendu, la propulsion d’un navire plutôt qu’un diesel marin ou la santé et l’hygiène des cultures plutôt qu’un kilo d’insecticide. Cela eut son utilité, nous faisant repenser la relation avec nos clients, mais aussi relativisant l’importance stratégique de la production qui pouvait donc être délocalisée.
Il est toujours curieux d’observer les cupesses sémantiques, très à la mode ces derniers temps: alors donc que nos biens manufacturés devenaient des services, les banques s’inventaient des produits comme s’il s’agissait de petits pains. Ce qu’elles n’ont jamais compris, c’est que leurs produits sont dangereux – toxiques et explosifs – non seulement pour les utilisateurs mais aussi pour les producteurs. Nous savons cela dans l’industrie chimique, pas les banquiers dans leurs officines.
Autre incompréhension: l’idée du sans limite. Dans une conférence donnée à Bâle il y a quelques années, Thomas Jordan, l’actuel directeur de la Banque nationale suisse, avait montré qu’une banque d’émission ne pouvait jamais se trouver en situation de faillite puisque, par privilège exclusif de l’Etat, elle est en tout temps en mesure de produire des liquidités, ce qui s’appelle communément faire jouer la planche à billet. Son bilan pourrait donc s’enfler à l’infini, quelles que soient les conséquences pour l’économie. L’ingénieur chimiste se demande comment cela est vraiment possible, tout processus ne pouvant pas créer plus de biens que les ressources qui y auront été introduites. C’est matériellement et thermodynamiquement impossible, sauf si l’on triche en apportant un soutien extérieur que l’on prend soin de cacher ou en diluant les richesses par l’inflation. Le banquier d’investissement ne connaît donc aucune limite. Il crée des produits dont la définition est tellement absconse qu’il faut douter de toute réalité de leur contenu. Ce ne sont plus seulement les banques nationales qui créent de la monnaie et en contrôlent la quantité mais c’est tout le système financier qui fait de la cavalerie. Deux personnes qui la pratiqueraient seraient punies pénalement, un système qui vit de cela sous le couvert d’une autorité de régulation est loué pour la «valeur» qu’il créerait ainsi. Ponzi ne faisait pas pire.
Régulation impossible: le Crédit Suisse d’avant le 19 mars 2023 disposait de 14% de fonds propres, bien au-dessus des exigences américaines ou européennes. Cela ne l’a pas empêché de se trouver sous la menace d’un manque de liquidité, au bord même de la faillite. Aurait-on oublié que l’on peut disposer de 100% de fonds propres et néanmoins se trouver en défaut de paiement? Aurait-on aussi oublié que, dans ce ratio, le 100 de cent pour cent n’est qu’une évaluation prophétique de la valeur d’un bilan? Pourtant une grande partie du personnel des banques et les centaines d’agents des autorités de régulation financière (SEC, FINMA, FCA, AMF, AEMF, etc.) sont confortablement payés pour pratiquer un intense ping-pong où tout ça est mesuré et vérifié (compliance) plusieurs fois, sans rien empêcher; pourtant ce système régulé abrite les causes de ses propres désordres. A quoi donc servent tous ces agents, à s’escroquer en couronne?
La notion même de produit financier fait aussi problème. Si les obligations et les actions sont assez clairement définies, ce n’est pas du tout le cas du reste. C’est d’ailleurs pourquoi la dernière page des prospectus qui décrivent ces ectoplasmes est une litanie en charabia juridique qui spécifie en lettres microscopiques tout ce qu’il ne faut pas comprendre et, surtout, désigne qui n’est en rien responsable pour la marchandise avariée.
Les «futurs», ventes ou achats à terme, sont pourtant une nécessité pour bien des secteurs d’affaire, surtout l’agriculture, et devraient n’être que cela: une assurance pour le prix d’achat ou de vente d’une commodité qui n’est pas encore disponible (mise en culture saisonnière) ou qui est mise en stock après récolte et dont le besoin ne se manifestera que plus tard. L’étymologie de hedging (tailler la haie) provient de ce secteur agraire. Tous les fermiers du Middle West ont dans leur bureau ou sur leur tracteur un écran où suivre les cours à terme au Chicago Board of Trade du maïs, soja ou blé, sans oublier le bioéthanol et ses subventions, autre poison économique.
Mais au-delà de cette nécessité existentielle pour ces secteurs peu nombreux, quelle contribution à la prospérité générale de l’économie font les instruments dérivés, et dérivés de dérivés, que sont les options, combinaisons de call ou put, Credit Default Swap (francophonie absente) ou Contracts for Difference? Les calculs savants de la valeur (sic) d’options ayant valu le Prix Nobel de l’économie à des gourous harvardiens ne sont pas obsolètes, ils n’ont jamais eu de validité. Certes, les échanges à haute fréquence de ces instruments financiers contribuent à multiplier les volumes des échanges dans les bourses et à faire tourner des liquidités scripturales, mais il reste à démontrer qu’ils enrichissent d’autres personnes que les gérants de ce casino. Il est donc, à mon avis, nécessaire d’ériger une muraille de Chine pour séparer ce monde de celui de la banque au service de l’économie, de faire renaître partout un Glass-Steagall Act de 1933. Le métier de banquier redeviendra ennuyeux et restera profitable, le trading correspondant aussi. Celui de l’illusion financière pourra être totalement dérégulé puisque chacun restera libre de s’y perdre à ses propres risques. Les acteurs actuels s’opposent vivement à cette séparation car ils savent qu’à défaut de pouvoir piquer les épargnes solides des gens normaux pour alimenter leurs chaudières, leurs affaires risquent bien de ne plus prospérer. Qu’il en soit ainsi! Le capitalisme sauvage restant bien confiné dans son zoo, le civilisé restera ouvert et accessible au plus grand nombre et en toute honnêteté.
Michel de Rougemont
https://blog.mr-int.ch/?p=9542
Article original publié sur Antipresse, un magazine en dehors des clous.
1 Exemple: Credit Suisse: la fête est finie – Le Temps
2 Rougemont, M. de (2021) La grande illusion du sauvetage de la planète par une remise à zéro. Comment les cercles économiques et financiers se laissent convaincre avec complaisance. MR-int.