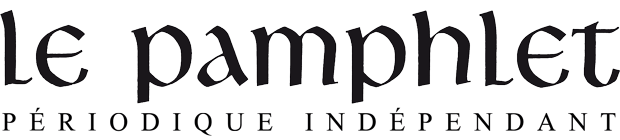Editorial
Les économistes de gauche prônent une utilisation de la fiscalité comme outil de justice sociale et de répartition des ressources. Je n’ai jamais fait mystère de mon aversion pour cette vision des choses, qui mène nécessairement à un système confiscatoire qui porte préjudice à ceux qui créent de la richesse, au bénéfice de ceux qui parfois se laissent vivre.
On me rétorquera que nombre de familles vivent en dessous du seuil de pauvreté en Suisse même et qu’au vu de la richesse du pays cela est intolérable. J’en conviens. Néanmoins, je persiste à penser que subventionner ceux qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts en puisant dans les poches des plus nantis ne mènera qu’à la fuite des gros contribuables vers des cieux plus cléments.
Le problème principal des bas revenus est le manque de qualifications. Le système éducatif doit être revu pour corriger ce qu’il est aujourd’hui, un outil dogmatique et égalitariste qui envoie à l’université le premier ignare venu, alors qu’il devrait être la porte d’entrée dans le monde du travail. La société a besoin de professionnels de toutes sortes et il vaut mieux être un artisan de talent qu’un juriste médiocre.
J’entends d’ici les cris d’orfraie des chantres de l’égalité des chances et des hautes écoles pour tous. Mais il y a là une confusion sémantique. L’égalité des chances signifie que, quel que soit le milieu d’où vous venez, si vous avez du talent, vous devez pouvoir accéder aux études qui vous conviennent. A aucun moment il n’a été question d’avoir des analphabètes en faculté des lettres. Or cette erreur d’interprétation a mené l’éducation au fond du trou. Les élèves de la terminale à options (TAO) de mon époque, qui se préparaient à un apprentissage, étaient regardés par ceux de prégymnasiale comme une bande d’orangs-outangs au quotient intellectuel quasi négatif. Il faut admettre que nous étions de grands sots tout imbus de notre propre importance, tant on nous avait dit que nous avions des «capacités», comme si nos camarades de TAO n’en n’avaient aucune. Combien de bons boulangers, mécaniciens, peintres, paysans et tant d’autres professionnels indispensables à la collectivité sont sortis de ce que nous considérions comme le rebut de l’école? Il faut être parfaitement clair: la société vaudoise n’a pas besoin de trois cents juristes chaque année. Ainsi, les pauvres diplômés en droit se retrouvent à devoir se recycler dans un autre domaine, à faire des petits boulots qui n’ont rien à voir avec ce qu’ils ont étudié. Et pendant ce temps-là, on ne trouve ni électriciens ni boulangers et le monde paysan s’éteint.
La tendance actuelle est de réduire les sections à un tronc commun jusqu’à la fin de l’école obligatoire, réduisant par là même les exigences, afin que tous puissent obtenir le diplôme de fin d’études. Je pense que l’on devrait faire exactement le contraire: tous les élèves sortant de l’école devraient savoir parler, lire et écrire le français, maîtriser les quatre opérations mathématiques de base et la règle de trois, et avoir étudié les événements marquants de notre histoire ainsi que les principaux philosophes. Comprendre le monde qui nous entoure et pouvoir communiquer par la parole plutôt que par les poings. Toutes les autres matières devraient être des options choisies en fonction des capacités et des aspirations des élèves. Julien montre un talent pour le dessin? Six heures d’aquarelle par semaine. La petite Sophie est douée en langues? Italien, allemand, espagnol. Frédéric aime les chiffres? Maths, physique et chimie. Christopher aime la cuisine? Cours de pâtisserie et œnologie. On pourrait préparer les enfants à devenir de grands professionnels en valorisant les domaines dans lesquels ils sont à l’aise.
Des individus bien formés à des métiers qu’ils ont du plaisir à exercer pourraient réduire le nombre d’employés non qualifiés et par là même la pauvreté en général.
Michel Paschoud
Thèmes associés: Divers - Ecole - Economie - Jeunesse - Politiques diverses
Cet article a été vu 1783 fois