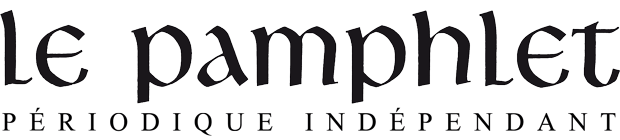Editorial
«Moi, Monsieur, j’ai des principes, je suis même à cheval dessus, c’est vous dire où je me les mets.» Cette boutade m’a toujours fait rire, bien que, lorsque l’on regarde aujourd’hui les membres du gouvernement socialiste espagnol, Pablo Sanchez en tête, on se dise que l’on ne pourrait pas en trouver meilleure illustration.
Je ne vais pas me lancer dans une analyse pour savoir qui a raison ou tort dans le grand débat sur la loi d’amnistie négociée entre la gauche espagnole et les partis indépendantistes pour assurer l’accès au pouvoir du sieur Sanchez, d’un part parce que je ne serais pas objectif et, d’autre part, parce que je ne suis pas compétent en matière juridique. Tout ce que je puis dire, c’est que je suis favorable à l’amnistie des dirigeants catalans qui ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir offert la possibilité aux Catalans de s’exprimer dans les urnes.
Non, ce que démontre cette affaire, c’est la fidélité à géométrie variable dont font preuve les politiciens de tous bords à l’égard de leurs principes lorsqu’il s’agit de s’accrocher au pouvoir, voire aux privilèges dont ils bénéficient.
Grâce à internet, tout est en libre accès et on ne compte plus les vidéos où l’un ou l’autre membre des élites dirigeantes espagnoles se fait prendre la main dans le sac en train de contredire, avec assurance, un discours qu’il n’avait tenu que quelques mois auparavant.
J’irai même plus loin: on en vient à se demander s’il y a réellement des principes et une éthique dans le monde politique espagnol, lorsque l’on voit le nombre ahurissant de scandales de corruption qui éclaboussent tous les partis. Et le pire, c’est qu’ils ne se démontent pas et que les électeurs continuent à voter pour eux. C’est stupéfiant!
Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’attitude de ces sans-vergogne? Tout d’abord que la politique devrait être un sacerdoce, insuffisamment lucratif pour n’attirer que des vocations sincères. La professionnalisation de la politique, en Espagne comme en France, déconnecte les élus des préoccupations de leurs concitoyens et du véritable objectif de leurs charges, qui est d’être les représentants de leurs électeurs.
Mais, au-delà, ne peut-on se demander si la démocratie parlementaire ne contient pas le germe de sa propre déchéance? L’être humain est ce qu’il est, en général plutôt imbu de lui-même, égoïste, fainéant et corruptible. Et si le nouveau qui entre en politique est une exception, on se chargera de le faire rentrer dans le rang. Le système même des partis avec leurs consignes et leurs dogmes ne constitue pas un terreau fertile à l’émergence d’hommes et de femmes politiques d’exception.
Rappelons-nous la chance que nous avons, en Suisse, de bénéficier du moins mauvais des systèmes démocratiques. Nous ne nous en rendons pas compte de l’intérieur, mais nos voisins nous envient ce pouvoir que nous avons de contrecarrer les délires de notre parlement au moyen du référendum, d’agir au moyen de l’initiative, et la culture du débat politique que nous donnent nos nombreuses votations. La démocratie semi-directe ne pourrait probablement pas s’appliquer facilement en France ou en Espagne, non que les moyens feraient défaut, mais bien par manque d’éducation au rôle du citoyen.
Alors, certes, il y a certains présidents hexagonaux qui se croient en droit de nous donner des leçons, mais il se trompent lourdement.
Il est vrai que les «petits Suisses» sont lents, en matière de prise de décision. Mais c’est ce qui nous permet une stabilité politique, qui attire nombre d’entreprises et d’investisseurs, lesquels contribuent à la prospérité de la Confédération.
Quitte à paraître un peu orgueilleux, j’affirme, comme Gilles, que «y’en a point comme nous».
Michel Paschoud
Thèmes associés: Ethique - Politique fédérale - Politique internationale
Cet article a été vu 1731 fois